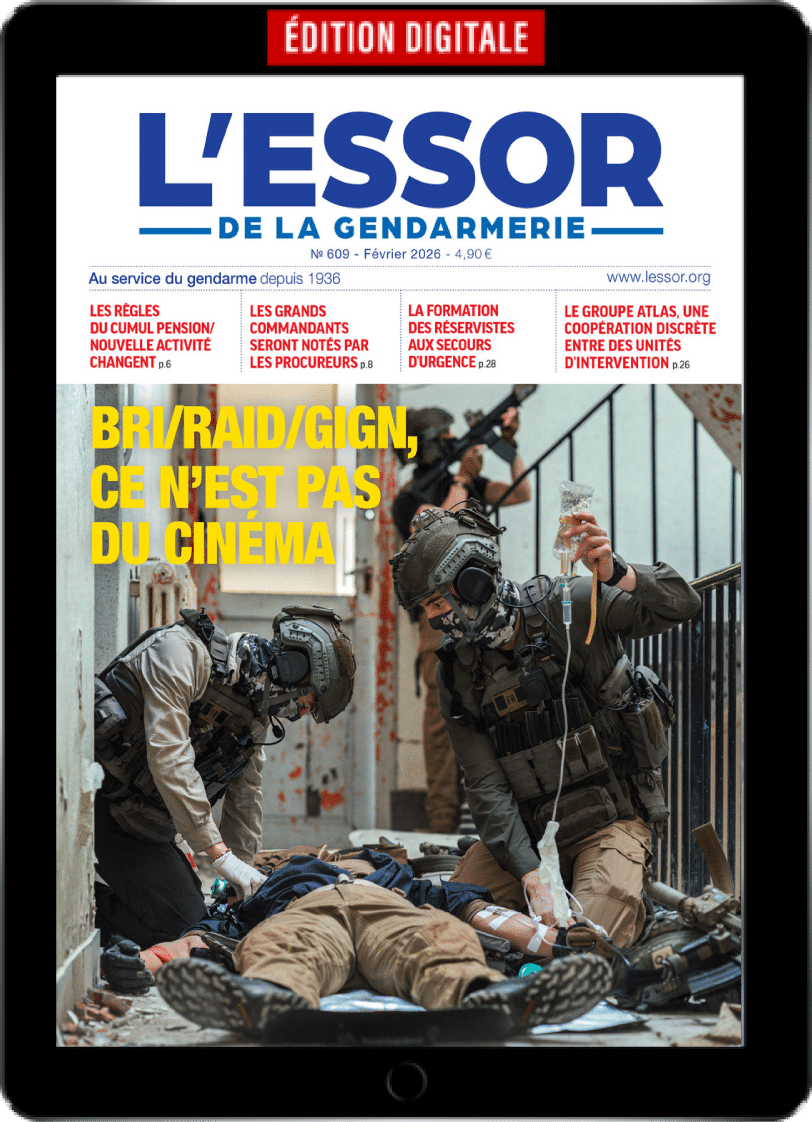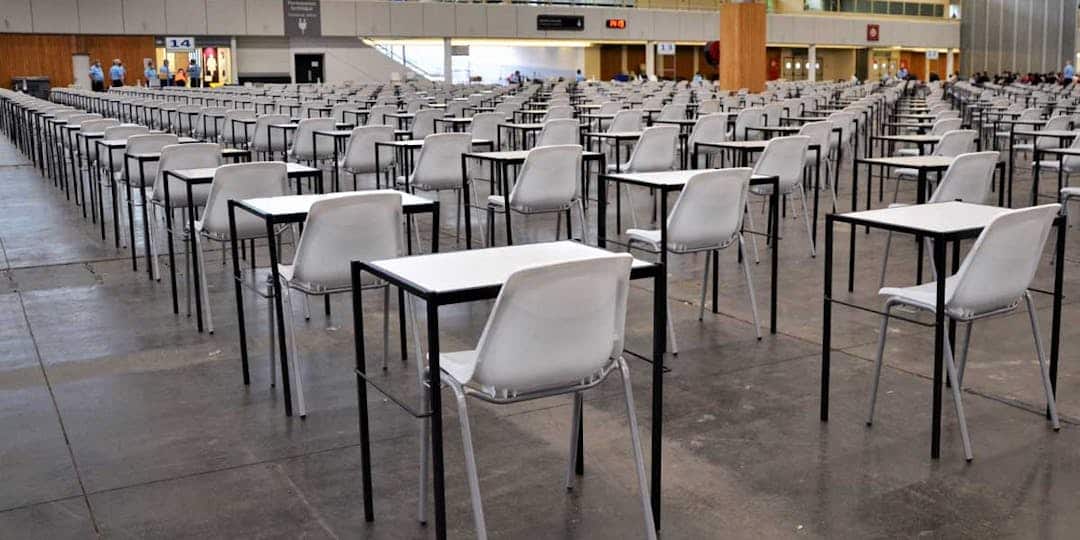En les obligeant à contrôler les attestations de déplacement de manière répétitive et en vertu de règles floues, le premier confinement a entraîné une perte de sens chez les forces de sécurité et affecté négativement leurs rapports avec la population et avec leur hiérarchie. C’est ce qui ressort d’une étude menée par Marion Guénot, chargée de recherches au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales (Cesdip).
Cette sociologue a en effet souhaité évaluer les conditions de travail des policiers et des gendarmes, estimant qu’ils étaient les grands oubliés des études sur les travailleurs de première ligne. "C’était un point aveugle de ces études car on a tendance à les considérer comme le bras armé de l’état, dans une vision déshumanisée", explique la chercheuse.
Un questionnaire diffusé par Gend XXI et trois syndicats de Police
Elle a donc interrogés gendarmes et policiers via un questionnaire en ligne. Pour le diffuser, Marion Guénot s’est appuyée, côté Gendarmerie, sur l’association professionnelle nationale de militaires Gend XXI et, côté Police, sur trois organisations syndicales (Unité SGP-police FO, CGT police et le collectif Union des policiers nationaux indépendants). Après avoir recueilli "plus de 1.000 réponses, dont 780 exploitables", elle a mené une quarantaine d’entretiens téléphoniques d’une heure en moyenne, avec "les volontaires qui avaient laissé leurs coordonnées".
Covid long: une année de calvaire pour une gendarme
Dans ces entretiens, Marion Guénot a noté "beaucoup de colère à l’égard des supérieurs hiérarchiques locaux et des décisions politiques". Par ailleurs, "l’attribution des primes Covid a été la source de très vives tensions en interne, notamment d’après les gendarmes interrogés".
Le flou des directives initiales, qui ont entraîné incompréhensions et contestations chez nombre de citoyens de bonne foi, a accentué le malaise perçu par la chercheuse. Elle rappelle que de précédents "commentaires ont souligné l’improvisation de ces mesures, faisant reposer sur les épaules des fonctionnaires de terrain le "discernement" quant à des situations individuelles parfois ambiguës, ainsi que l’utilisation d’une police "réponse à tout pour gérer et contenir une population jugée a priori comme peu obéissante et comme peu raisonnable"". Une approche qui n’était pas une fatalité. Marion Guénot rappelle en effet l’exemple des Pays-Bas où "la Police avait été mobilisée pour faire de la prévention, ce qui modifie totalement les rapports entre la police et la population".
Pendant ce temps, "en France, au printemps 2020, 20,7 millions de contrôles ont été réalisés, donnant lieu à 1,1 million de contraventions. (…) Là où, en temps normal, les professionnels ciblent ceux qui leur semblent suspects pour déclencher des contrôles, ces derniers sont devenus systématiques".
Une mission jugée "non valorisante" par "la totalité des agents entendus en entretien", pointe Marion Guénot qui cite un gendarme à qui "cela rappelle des heures sombres" et qui ajoute, en imitant l’accent allemand: "Contrôle, police ! Les papiers !"
Vaccination obligatoire : les gendarmes devront être vaccinés pour le 15 septembre 2021
"C’était vraiment quelque chose qui ressortait très fortement", explique Marion Guénot. "Certains ont d’ailleurs tenté de désobéir pour être plus souple avec la population et chercher à faire davantage preuve de pédagogie. Ils préféraient rappeler le règlement que de verbaliser". Cette posture est cependant apparue dans un second temps, après une application stricte des consignes qui a été perçue d’autant plus durement "qu’on sortait d’une période assez compliquée avec les Gilets jaunes et la réforme des retraites".
Aucun officier parmi les répondants
Parmi les répondants, seuls 10% environ étaient des gendarmes, explique Marion Guénot qui précise qu’elle ne visait pas la représentativité, mais au moins la diversité géographique. Les gendarmes en question sont affectés en brigade ou en unités routières. On ne retrouve aucun officier parmi eux, seuls des sous-officiers et des gendarmes adjoints volontaires ont en effet décidé de répondre au questionnaire.
Celui-ci portait sur les conditions de travail et la question de la réorganisation du travail a été évoquée. Les mesures en ce sens "ont été très inégales selon les territoires", écrit Marion Guénot qui rappelle que "certains commissariats ont tout simplement fermé, induisant des charges de travail supplémentaires pour les commissariats ou casernes de gendarmerie voisins".
Les nouveaux rythmes de travail adoptés, visant avant tout à éviter les croisements de personnels, ont fait disparaître les discussions entre collègues et autres repas en commun.
Par ailleurs, "par manque de moyens et de consignes claires, peu de mesures d’hygiène ont été prises dans les services", relève Marion Guénot. Des témoignages à nuancer cependant: lors du premier confinement, des gendarmes interrogés par L’Essor avaient décrit une application rigoureuse d’un protocole de désinfection des locaux dans les unités, même si la ventilation était le parent pauvre de ces mesures. "L’une des rares consignes données et suivies sur le plan national a été, dans un premier temps, l’interdiction de porter un masque", ajoute la chercheuse. Une directive qui s’expliquait, en Gendarmerie, par le peu de stock à disposition et la volonté d’économiser les rares protections à disposition.