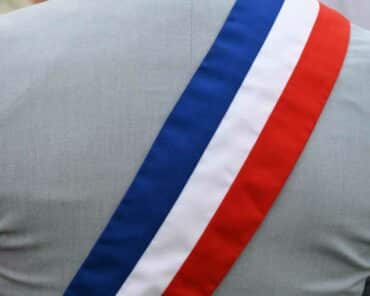Par Gabriel Thierry • Illustration ZZIGG
Les gendarmes de la section de recherches d’Orléans vont buter pendant plusieurs décennies sur le mystère de la petite martyre de l’A10, cette fillette sans nom retrouvée morte en bordure de l’autoroute. Mais leur ténacité finira par payer.
J-4 pour ces agents d’entretien de la société Cofiroute affectés à l’A10, dans le Loir-et-Cher. Ce mardi 11 août 1987, il reste encore quelques jours avant l’un des pics annuels de circulation automobile, le fameux week-end du 15 août. C’est sur cette période que se concentre le trafic automobile des départs et des retours de vacances. Alors, juste avant l’échéance, les agents sont attentifs.
Et justement, ce jour-là, vers 15 heures, au kilomètre 135 de l’autoroute, comme le racontent les journalistes Georges Brenier et Adrien Cadorel dans le livre consacré à cette affaire (L’Inconnue de l’A10 : l’enquête, La Manufacture des livres), les deux agents, Romain et Frédéric, sont intrigués.
Alors qu’il débroussaille l’herbe qui pousse sous les glissières de sécurité du côté de Suèvres, dans le sens de Paris vers la province, Frédéric voit une forme bleu clair dans l’herbe. Il s’approche pour ramasser l’objet, sans doute jeté par un automobiliste peu consciencieux.
Stupeur : deux pieds dépassent d’un côté et, de l’autre, des cheveux bruns et bouclés. Manifestement, il s’agit d’un enfant mort.
Ce mardi, Gilbert Meunier, l’un des gendarmes auxiliaires du peloton d’autoroute, est en patrouille avec trois autres militaires. Il voit au loin les deux agents de Cofiroute, qui ont déjà alerté leurs supérieurs, leur faire de grands signes. Ils s’arrêtent. Comme il le racontera plus tard au quotidien régional La République du Centre, le gendarme trouve le petit cadavre au pied d’un poteau, enveloppé dans sa couverture en laine bleu clair. L’enfant est vêtu d’une culotte blanche tachée de sang, d’un maillot de corps à rayures roses, blanches et bleues, lui aussi taché de sang, et d’une robe de chambre à carreaux rouges et bleus. L’enfant semble âgé de 2 ou 3 ans.
La découverte est macabre, même pour des gendarmes habitués à être confrontés à l’horreur. « J’étais habitué à voir des accidents, on se blinde… Mais je m’en serais bien passé, se souvient Gilbert Meunier. Elle était sur le bord du talus. Entre deux champs, il y avait un chemin. La petite avait des morsures, des brûlures, mais elle gardait un visage reposé. » Et l’ancien gendarme de préciser à France Info : « J’ai d’abord eu un sentiment de révulsion, puis j’ai été révolté, choqué. On s’en prenait à l’innocence même. » D’une façon d’ailleurs particulièrement glaçante : le corps présente de nombreuses ecchymoses, et même des traces de dents évoquant des morsures humaines. « Cette enfant n’était qu’une plaie de la tête aux pieds », s’indigne l’un des magistrats de Blois, tandis que le premier magistrat instructeur, Georges Domergue, y voit « pratiquement d’un cas d’anthropophagie ».
Le gendarme, avec simplement une sacoche dans l’estafette, ne peut pas entreprendre grand-chose pour l’enquête. Mais il peut déjà assurer l’essentiel : préserver la scène de crime pour éviter de faire disparaître de façon involontaire des indices.

L’émotion des enquêteurs
Comme ses collègues, le gendarme est extrêmement ému par cette découverte.
Il ne restera pas dans la région, il va partir en Guyane quatre ans plus tard. Mais, grâce à sa mère, il va suivre l’affaire de loin. Elle lui envoie régulièrement des coupures de presse sur l’enquête. Et quand il passe dans les environs, le gendarme va se recueillir sur la tombe de l’enfant.
L’adjudant Alain Petat, lui, a gardé pendant quatorze ans la photo de l’enfant dans son portefeuille, jusqu’à son départ en retraite.
Ils sont d’ailleurs nombreux à conserver précieusement sur eux cette photo, comme le premier juge d’instruction chargé de l’affaire. La garder près de soi, c’est se souvenir de cette promesse qu’ils se sont faite : donner un nom à l’inconnue de l’A10, c’est ainsi que l’enfant est surnommée, et résoudre une énigme criminelle révoltante.
L’émotion est palpable au cimetière de Suèvres, où l’enfant a été enterré. Ils sont environ une vingtaine d’habitants à lui rendre hommage, ce 9 septembre 1987. Tous sont profondément émus. Le garde champêtre, qui a porté le cercueil, dépose une grande gerbe de fleurs blanches sur la tombe sans nom. L’abbé implore de son côté le Seigneur d’éclairer « les tortionnaires de cette enfant, pour qu’ils reconnaissent leur crime ». Le maire, Kléber Cousin, a fait enfin graver une plaque mortuaire, avec ce sobre message : « A la mémoire de la petite inconnue de l’autoroute A10. »
L’autopsie menée à Blois par le docteur Olivier O’Byrne n’a pas permis de mettre un nom sur le visage de l’enfant. On sait cependant qu’il s’agit d’une petite fille à la peau mate, âgée entre 3 et 5 ans, qui pèse une vingtaine de kilos, et qu’elle a dû souffrir le martyre. Battue à la tête et sur le corps, elle a été mordue, avec un mamelon qui a même disparu, comme s’il avait été arraché à coup de dent. Les cicatrices révèlent que certains coups sont anciens, tandis que les plaies témoignent de violences plus récentes.
Quand le corps est découvert, Alain Petat, un pilier de la section de recherches d’Orléans, est en vacances.
Le maréchal des logis-chef avait expliqué à L’Essor comment les enquêteurs avaient eu à cœur de travailler sur ces investigations. « Il y avait toujours deux ou trois gars qui suivaient le dossier. En plus des autres enquêtes, des demandes étaient envoyées. Lorsque les réponses arrivaient, elles étaient épluchées, et généraient parfois d’autres investigations. »
L’affaire se rappelait d’ailleurs régulièrement aux gendarmes : le lieu où a été trouvé le corps, à une grosse trentaine de kilomètres d’Orléans, est un point de passage fréquent des militaires. A la tête de la section, les officiers se transmettent le flambeau au rythme des mutations. Ainsi, quand Marc de Tarlé arrive, en 2004, son prédécesseur l’enjoint à continuer à faire vivre l’enquête. « Le meurtre de cette fillette, c’est LE dossier qui tenait le plus à cœur de la section de recherches d’Orléans. Les enquêteurs ne l’ont jamais lâché », dit-il au Parisien. L’enquête ne s’est « jamais arrêtée. Elle a traversé les générations d’enquêteurs, de commandants de section de recherches.
Elle appartenait à la mémoire de l’unité. Nous avions l’obligation morale d’aboutir ».
Faire le maximum
Les gendarmes mettent donc toutes leurs ressources pour résoudre cette énigme criminelle. Mais cela va leur demander trente et un ans. A la tête de la section de recherches d’Orléans à l’époque, Rémy Maunier est le premier à être chargé du dossier. Malgré le souci de bien faire des gendarmes du peloton d’autoroute, la scène de crime a été piétinée quand il arrive sur place.

« On sait déjà qu’on aura dû mal à retrouver des traces et indices, expliquait-il à L’Essor. Mais je laisse quand même une équipe sur place, pour recueillir un maximum d’éléments matériels. » Toutefois, les militaires ont de la chance. Les enquêteurs de l’unité sont en pointe pour leur époque. Ils sont les premiers gendarmes à être équipés d’un véhicule mobile de police technique. Cet outil permet aux enquêteurs formés de faire des prélèvements, des relevés et des scellés, dans les meilleures conditions possibles.
A l’époque, trois ans après le fiasco de l’affaire Grégory, la Gendarmerie met les bouchées doubles sur la police scientifique. Ce dossier a fait comprendre aux gendarmes l’importance cruciale des premières heures de l’enquête et du recueil méticuleux d’indices et de preuves.
De grands moyens
Outre l’IRCGN, créé en février 1987, les militaires des sections de recherches ont été encouragés à plancher sur la conception d’un véhicule adapté aux prélèvements sur les scènes de crime. « C’est notre projet qui avait été retenu, et nous étions donc dotés du premier véhicule aménagé pour effectuer rapidement les prélèvements, les conserver dans de bonnes conditions et les envoyer dans des laboratoires », se souvient Rémy Maunier.
« Sur le moment, nous ne savons pas comment va s’orienter cette enquête, ajoute-t-il. Mais pour ce qui est de la recherche du renseignement et du recueil des indices, nous savons faire, et c’est quelque chose que nous pouvons faire de la meilleure façon possible.
On ne sait pas si cela va servir ou non, cela fait simplement partie des fondamentaux. »
Alors que l’utilisation de l’ADN pour résoudre des enquêtes criminelles est balbutiante – le premier criminel confondu par son ADN, Colin Pitchfork, avait été condamné par la justice anglaise en janvier 1988 –, les gendarmes vont avoir la présence d’esprit de récupérer les vêtements et la couverture dans laquelle l’enfant a été enveloppé. On retrouve ainsi six cheveux accrochés à la couverture enveloppant l’enfant. « Nous ne nous sommes pas posé la question de l’ADN, puisqu’à l’époque cela n’existait pas, précise Rémy Maunier. Nous les avons donc placés sous scellés, sans imaginer, à l’époque, que cela servirait trente ans après. »
Une piste se distingue rapidement chez les enquêteurs. Puisque personne ne s’est manifesté, le crime est peut-être le résultat d’un horrible huis clos familial. Même si toutes les hypothèses sont envisagées, cette explication semble la plus plausible. Ainsi, au parquet de Blois, on pense qu’une fois l’identité de la fillette retrouvée, les chances de mettre la main sur les auteurs seront fortes. Aussi, après l’enterrement de l’enfant à Suèvres, les gendarmes mettent en place une surveillance discrète autour de la tombe : un parent, rongé de remords, pourrait peut-être venir se recueillir ?
De grands moyens sont déployés. D’abord, les gendarmes explorent les environs en faisant une vaste opération de porte-à-porte dans les communes du coin. Puis, faute d’éléments intéressants, ce cercle est élargi au maximum. Environ 65 000 écoles sont visitées à la rentrée scolaire, et 6 000 médecins ou assistantes maternelles sont rencontrés.
Les enquêteurs diffusent massivement, en septembre 1988, la photo de l’enfant dans les mairies ou les postes, espérant que quelqu’un reconnaisse la victime. Et son signalement est transmis dans une trentaine de pays.
Rémy Maunier précise alors à France Soir : avec cette terrible photo, les gendarmes supplient la population « de fouiller dans leurs souvenirs ». En vain, l’identité de l’enfant reste un mystère.
Les gendarmes passent également de relais routier en restaurant pour retrouver un indice correspondant au dernier bol alimentaire de la fillette, de la langue de bœuf et des légumes.
Ils tentent de savoir qui est passé par cette autoroute ce jour-là.
Et, comme d’habitude dans ce genre d’enquête très médiatisée qui a ému l’opinion, il faut vérifier les dénonciations ou les faux indices.
Les gendarmes tentent même de faire parler la robe de chambre, comme l’expliquent les journalistes Georges Brenier et Adrien Cadorel. Peine perdue : le vêtement est une contrefaçon. Autre piste décevante : des grains de sable ont été retrouvés dans cette robe de chambre. Le laboratoire estime qu’ils présentent « de grandes analogies » avec ceux des alluvions de rivière.
Il en conclut que l’enfant devait vivre à la campagne, peut-être aux alentours d’Oucques et de Marchenoir, à quelques dizaines de kilomètres de la découverte du corps.
Les gendarmes ne le savent pas, mais ils sont sur de fausses pistes.
Résultat, c’est l’impasse. Une première ordonnance de non-lieu est rendue en février 1991. Deux ans plus tard, la justice tente un coup de poker en s’appuyant sur la télévision. Des reporters de l’émission Témoin numéro 1, de TF1, retracent les difficultés de l’enquête. Cela va susciter de nombreux appels et courriers dans un dossier qui n’en manque pas.
Les gendarmes en charge de l’enquête ne se découragent pas. Et ils continuent de faire vivre le dossier, pour éviter l’extinction des poursuites. Une nouvelle autopsie est menée en décembre 1995, avec cette fois-ci un prélèvement en vue d’expertises génétiques. Mais malgré l’identification d’un ADN mitochondrial, l’enquête reste au point mort, et une nouvelle ordonnance de non-lieu est rendue en août 1997.

Quand l’ADN parle
Près de dix ans plus tard, le dossier semble malheureusement en passe d’être prescrit.
Sauf que, en janvier 2007, à quelques mois de l’échéance, le patron de la section de recherches, Marc de Tarlé, relance la machine judiciaire. Dans un courrier aux magistrats, l’officier explique qu’en raison des progrès des expertises génétiques, il existe désormais une très forte probabilité d’extraire un ADN nucléaire à partir des ossements conservés.
Concrètement, ces analyses génétiques pourraient aider à mieux identifier la victime, mais aussi à découvrir des ADN de proches ayant vécu avec elle. Ceux qui sont capables de ces prouesses, ce sont les experts de l’Institut génétique Nantes-Atlantique.
Comme l’expliquent les journalistes Georges Brenier et Adrien Cadorel, le professeur Jean-Paul Moisan et le patron de la section de recherches échangent régulièrement des informations.
Et le second pressent que le premier pourrait faire une découverte capitale dans l’enquête.
Le parquet de Blois y croit aussi, et une nouvelle information judiciaire est ouverte pour meurtre, recel de cadavre et violences habituelles sur mineure de moins de 15 ans.
Un an plus tard, en février 2008, bonne nouvelle : le nouveau rapport d’expertise génétique a mis en évidence la présence de deux ADN, un masculin et un féminin, en plus de celui de la victime. Ce sont vraisemblablement les parents de la victime, qu’on commence à mieux situer : ils seraient originaires d’Afrique du Nord.
C’est un énorme bond en avant, qui sur le moment se solde toutefois par une impasse : les comparaisons établies dans le fichier national des empreintes génétiques sont infructueuses. Et l’entraide internationale demandée par la justice française ne donne rien.
Qu’à cela ne tienne. Les gendarmes explorent les autres pistes à leur disposition. Comme le témoignage de cet automobiliste roulant vers Paris, Guy, qui se souvient avoir vu une femme brune affolée traverser les voies. Luc, un chauffeur routier, signalait, lui, avoir croisé une voiture blanche, un 504 ou un 505 break, arrêté au bord de la route. Un homme et une femme se tenaient à proximité, avec une petite fille tenue par les cheveux et frappée.
Les militaires tentent enfin de faire parler les résidus de peinture retrouvés sur le vêtement de la fillette, qui étaient utilisés dans une usine Citroën Méhari de la région de Blois.
Mais alors que ces différentes pistes se soldent par des impasses, inlassablement, la piste de l’ADN se renforce. Une nouvelle expertise est réalisée en mai 2013. Deux nouveaux profils masculins et un profil féminin sont identifiés sur les objets mis sous scellés. Ce sont vraisemblablement les frères et sœurs de la victime.
Aussi, même si le parquet de Blois prend, en mars 2015, des réquisitions définitives aux fins de non-lieu, l’information judiciaire n’est pas close. Un jour, l’ADN parlera… Qui sait ?
Le 27 avril 2017, ce jour est arrivé. L’un des profils génétiques retrouvés sur la couverture vient de matcher dans le Fnaeg.
Un nom pour l’enfant
A Villers-Cotterêts, A. est bien connu. Avec ses frères, ce jeune homme d’une trentaine d’années gère quatre commerces – une boulangerie, une boucherie, un kebab et une alimentation. Ce n’est visiblement pas un tendre, et il n’hésite pas à faire le coup de poing, comme en ce soir d’été 2016 où il frappe l’un de ses clients pour une histoire de pâtisserie.
Un problème de comportement qui lui vaut un passage par la Gendarmerie. Rigoureux, l’officier de permanence prélève son ADN au passage. C’est la procédure, mais tous les gendarmes en auraient-ils fait autant ? Quoi qu’il en soit, ce geste va avoir une importance capitale. L’année suivante, le jeune homme est en effet condamné à six mois de prison avec sursis. Son ADN est alors versé au Fnaeg.

Les enquêteurs, qui désespéraient d’avoir un jour un match, obtiennent enfin une correspondance. A. est le frère de la victime. Avec cette découverte, l’enquête des gendarmes s’accélère. Ils apprennent d’abord que le jeune homme avait trois frères et deux sœurs.
La famille, arrivée en France en 1980, a d’abord vécu en région parisienne, à Levallois-Perret, puis à Vitry-sur-Seine. Détail intriguant, ils s’aperçoivent qu’Inass, l’une des filles, est mentionnée sur la fiche d’état civil délivrée en 1986 à Halima, la mère. Mais l’enfant n’est plus signalée par la suite. La petite martyre de l’A10 a donc enfin un nom, confirmé ensuite par l’ADN.
Il s’agit bien d’Inass Touloub, née le 3 juillet 1983 à Casablanca, au Maroc. Les enquêteurs et les magistrats qui ont planché sur l’enquête ne peuvent retenir leurs larmes.
Mais qui est donc Inass ? On sait désormais qu’elle a d’abord été élevée au Maroc par sa grand-mère maternelle. Sa mère, Halima, une ancienne institutrice, avait rejoint quelques années auparavant son mari Ahmed, en France, à Vitry-sur-Seine. Ils ont déjà deux filles. Début juin 1983, Halima, enceinte – une grossesse non déclarée –, revient à Casablanca pour célébrer le ramadan.
C’est là qu’elle accouche, quelques semaines plus tard, d’Inass. L’enfant ne revient pas avec sa mère dans l’Hexagone. Selon ses déclarations à la justice, elle découvre au moment du départ que le retour d’Inass n’a pas été prévu par la famille. « Je suis rentrée vide du bébé, je pleurais, je disais : pourquoi je rentre sans mon bébé », explique-t-elle au juge d’instruction Denis Dabansens. Le retour d’Inass se fait finalement à la fin de l’année 1984.
Selon l’enquête, c’est le début de l’enfer pour l’enfant.
Pour les magistrats, c’est en effet à ce moment que la maltraitance a commencé. Ahmed explique ainsi aux enquêteurs qu’Halima, sa femme, giflait, mordait, tapait et donnait des coups de pied à Inass. Il se souvenait, par exemple, de traces de brûlure au fer à repasser : son épouse lui aurait alors expliqué que c’était sa fille qui était tombée sur le fer.
Selon les constatations de l’IRCGN, les morsures identifiées correspondent à celles d’un adulte et de deux enfants différents, âgés entre 7 et 9 ans. Le rapport d’autopsie signale également que l’enfant était battue, de nombreuses plaies d’âge différent sont disséminées sur son corps. Une autre expertise estime même que les violences étaient telles que l’enfant avait dû être impotente pendant plusieurs semaines, l’empêchant, par exemple, de se déplacer normalement.
Ahmed l’admet rapidement devant les enquêteurs, visiblement soucieux de soulager sa conscience, trente ans après la mort de son enfant : Inass a vécu un calvaire. Mais il ne pouvait rien faire, ajoute- t-il, par peur de sa propre épouse.
Il craignait également que les autres enfants soient placés en famille d’accueil.
Le calvaire d’Inass
Le 10 août 1987, le calvaire d’Inass a pris fin de la pire des façons. Ce soir-là, Ahmed revient à la maison vers 22 heures. Selon ses déclarations, l’enfant est allongé, mort, sur un petit canapé. Sa compagne lui dit qu’elle ne parle plus et qu’elle est tombée dans les escaliers menant à la cave. Ses enfants expliquent plus tard à Ahmed qu’Inass avait sali des vêtements et que leur mère l’avait alors poussée dans l’escalier. Ahmed commence à marcher vers le commissariat. Mais, en chemin, il gamberge. Que vont devenir ses autres enfants ? Quelles vont être les conséquences pour la famille ?
Finalement, il opère un demi-tour. La famille embarque dans la Citroën BX beige et part pour le Maroc. Sur le chemin, ils s’arrêtent dans la nuit – lui restant au volant – pour déposer l’enfant au bord de la route, expliquant ensuite à leurs proches qu’Inass est restée en France. La mort de l’enfant devient un tabou dans la famille.
Halima ne va pas livrer les mêmes explications aux enquêteurs. Elle assure d’abord, contre toute évidence, que sa fille Inass est toujours vivante, qu’elle habite au Maroc avec son mari et ses trois enfants. Elle finira pourtant par admettre que son enfant est bien la petite inconnue de l’A10.
Elle « n’acceptait pas encore » sa disparition, explique la mère de famille. Elle assure également que l’enfant n’était pas encore morte quand ils ont entamé leur périple. Certes, elle était très faible, mais elle respirait, avant finalement de décéder sur ses genoux dans la voiture. Selon Halima, c’est son mari qui dépose Inass au bord de la route. Interrogés, les enfants les plus grands se souviennent, eux, d’un départ rapide et précipité, avec des cris et des larmes. Inass est enroulée dans une couverture, elle ne bouge pas. Les enfants ont compris que la petite est morte. L’une des sœurs se souvient juste avoir vu sa mère en haut des escaliers, et Inass en bas, inerte. Selon les experts, elle est vraisemblablement morte d’un choc hémorragique et traumatique.
Huis clos familial
Les enquêteurs vont tenter de comprendre les ressorts de ce terrible huis clos familial – une partie de la fratrie va découvrir à cette occasion l’existence de leur sœur. L’un des enfants décrit son père comme une personne très douce et travaillant beaucoup – Ahmed explique partir à 5 heures du matin et rentrer à 23 heures. Sa mère, qui s’occupait de la fratrie, adorait ses enfants. Mais, poursuit l’enfant du couple, Halima aurait souffert de son expatriation en France à la suite d’un mariage non désiré. En effet, selon Halima, ce mariage avait été voulu par la famille. Son mari ?
Il en voulait à son argent, dira-t-elle.
L’aînée de douze enfants est la fille d’un propriétaire foncier et immobilier. Ahmed, qui avait déjà conclu un premier mariage arrangé, l’avait rencontré en 1976. Pour la jeune institutrice – elle a exercé pendant neuf ans –, qui avait pourtant réussi un parcours scolaire rare à l’époque, ce départ implique la fin de sa carrière professionnelle. Ses diplômes ne sont pas reconnus dans l’Hexagone, et elle devient mère au foyer.
Un autre fils souligne également que, si les enfants n’ont jamais manqué de rien et que sa mère était affectueuse, elle avait aussi des problèmes psychiatriques. « Ma mère est quelqu’un d’instable, on ne peut pas la prendre au sérieux quand elle parle », dira également un autre enfant du couple.
Les aînées d’Inass se souviennent, eux, de crises violentes de leur mère, capable de les secouer violemment, de les gifler ou de les frapper à coups de pied et de bâton, avant ensuite, une dizaine de minutes plus tard, de les câliner.
Mais Halima donne un son de cloche différent, accusant son mari de taper les enfants, dont Inass. Avant de brosser un autre tableau familial, celui d’un père déçu d’avoir une nouvelle fille, et pas un garçon, et violent avec elle. Au contraire, Ahmed dira avoir été frappé par sa femme à coups de balai, de poings, et même avec une matraque de base-ball.
Elle l’aurait même menacé une nuit avec un couteau.
Des proches du couple feront état d’un père gentil, débonnaire, mais parfois fatigué, et d’une mère discrète, sortant peu, et se plaignant régulièrement de son mari. Ahmed et Halima finissent par se séparer en 2010.
Controverse juridique
Quelles sont donc les responsabilités exactes du père et de la mère d’Inass ? Halima, la principale mise en cause, a fini par admettre avoir frappé l’enfant, mais pas au point de la tuer. « Je ne suis pas un chien », ajoute-t-elle à propos des morsures, contestant avoir donné la mort à son enfant et avoir laissé son corps au bord de la route. Il faut désormais attendre les assises pour en savoir p
lus.
Mais le procès tarde à être audiencé, alors que les mis en cause ont désormais 71 et 68 ans.
La raison ? Une bataille juridique est en cours. Le juge d’instruction souhaitait en effet renvoyer les parents d’Inass pour « violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner », pour la mère, et pour complicité, pour le père. Une qualification inadéquate pour le procureur de Blois, qui a fait appel, demandant un renvoi pour meurtre.
En avril, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Orléans a finalement demandé au juge d’instruction de mettre en examen les parents pour acte de torture et de barbarie, en s’appuyant sur les constatations du rapport d’autopsie et du rapport d’expertise médico-légale. Une demande appuyée par deux associations de défense de l’enfant, Enfance et Partage et La Voix de l’enfant, parties civiles dans ce dossier.
Pour la première, la mère n’explique pas la présence des importantes lésions relevées sur le corps d’Inass, qui s’apparente, au vu des morsures sur les seins, à de la torture et de la barbarie. Halima ne pouvait ignorer, complète la seconde, qu’en infligeant de telles blessures elle allait donner la mort à son enfant, dont l’état de santé se détériorait.
Quant à Ahmed, l’association relève une complicité par abstention : le père avait le pouvoir et la capacité de s’opposer aux maltraitances, mais il s’est abstenu de le faire, dénonce-t-elle. Je savais qu’Inass était maltraitée, dira en substance ce dernier, honteux de sa lâcheté et de sa faiblesse, avant d’assurer n’avoir jamais imaginé que cette violence pouvait entraîner la mort de l’enfant.
Reste quelques énigmes qui ne seront sans doute jamais résolues plus de trente-cinq ans après les faits. Mais pourquoi donc la disparition d’Inass n’a-t-elle pas été remarquée à l’époque ?
Les enquêteurs ont tenté en vain de retrouver le médecin de la famille ayant suivi les enfants. Et, visiblement, des démarches avaient également été entreprises pour inscrire Inass en maternelle à Puteaux – la Justice se demande visiblement si cette inscription n’aurait pas précipité le drame : à la rentrée, les instituteurs auraient forcément compris que l’enfant était battue. Les gendarmes ont enfin retrouvé une étonnante mention dans un fichier de la Caf de Soisson, avec cette précision pour Inass : non à charge depuis le 1er août 1997.
Quoi qu’il en soit, avant même le début d’une conclusion judiciaire, les personnes ayant travaillé sur l’enquête ont déjà une première satisfaction. Celle d’avoir redonné son nom à la petite inconnue de l’A10. « C’est un immense soulagement, expliquait Rémy Maunier. Après le sort des mis en cause, c’est devant la justice. » Et d’ajouter. « C’est vrai, les gendarmes ont travaillé sur ce dossier, de la section de recherches à tous les gendarmes de France et de Navarre. Mais avec le recul, on s’aperçoit que c’est la somme de tous les gens qui ont bien voulu faire quelque chose pour faire avancer l’enquête qui a permis la résolution » de ce dossier.
Une façon de ne pas oublier Inass.